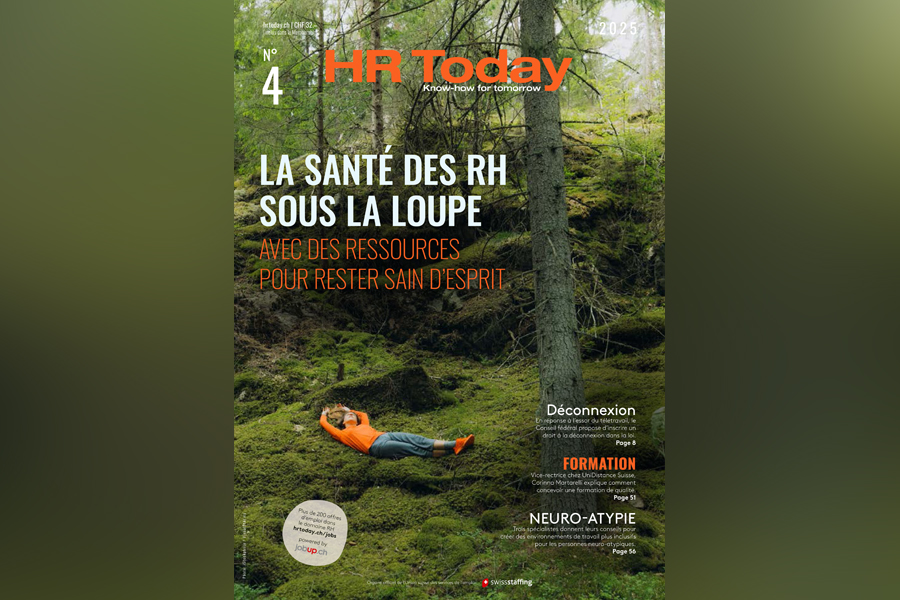Coopérer pour prospérer: et si l'agilité était la clé?
Les turbulences géopolitiques actuelles nous rappellent que la coopération est clé pour trouver des solutions durables. En organisation, la coopération et l'agilité permettent de gérer les tensions qui naissent lorsqu'on perçoit un écart entre ce qui est et ce qui pourrait être mieux.

Photo: iStock
Guerres de territoires, guerres de l’information, guerres commerciales... La coopération internationale traverse une période sombre. Ces conflits sont profonds, alimentés par des années de tensions, de rivalités et de méfiance. Chacun possède sa propre complexité, ses acteurs et leurs jeux d’alliances. Inutile d’imaginer qu’une clé diplomatique unique puisse les résoudre tous. Pourtant, une certitude demeure: ces conflits ne pourront se conclure favorablement et durablement sans coopération. L’histoire n’a cessé de le démontrer: aucun enjeu global ne peut être adressé sans le dialogue et la capacité à regarder plus loin que les frontières.
L’ONU définit la coopération comme «l’ensemble des mécanismes et actions par lesquels les acteurs publics et privés conjuguent leurs efforts, leurs ressources et leurs compétences pour atteindre des objectifs communs de développement durable.» Ainsi, bâtir un avenir viable repose sur des actions diverses et conjointes. Il ne s’agit pas d’appliquer une doctrine ou de suivre un protocole. C’est davantage une intention partagée de maintenir un équilibre pouvant être menacé à tout moment par un simple message sur X d’un dirigeant guidé par ses seuls intérêts. Cette fragilité est révélatrice des difficultés actuelles à œuvrer ensemble.
Qu’en est-il de la coopération dans les entreprises? La scène internationale ne reflète-t-elle pas, à grande échelle, ce qui se joue dans les organisations? La remise en question des modes de travail est déjà largement engagée et des solutions nouvelles sont recherchées. Dans ce contexte, l’agilité, omniprésente, est souvent décrite comme LA clé. Est-elle une alternative ou le prolongement naturel d’une coopération à bout de souffle face aux défis contemporains? Toutes les deux porteuses d’espoir, agilité et coopération méritent d’être explorées ensemble, afin de mieux saisir ce qui les rapproche et les distingue.
La coopération, un principe universel
Contrairement à l’agilité, la coopération est tout sauf un concept nouveau. Même si elle demeure un concept: une idée abstraite qui permet d’analyser et d’organiser des phénomènes complexes. Son ancienneté lui confère le statut de principe universel de prospérité. Elle fait consensus auprès de tous ceux qui défendent le bien commun, en tant que besoin fondamental de travailler ensemble. D’ailleurs, Yuval Noah Harari, historien et auteur de «Sapiens», considère la coopération comme l’un des éléments centraux qui ont permis à l’Homo sapiens de dominer les autres espèces, grâce à sa capacité unique à coopérer à très grande échelle. Selon lui, cette faculté à créer des structures sociales complexes repose sur notre foi collective dans des récits inventés.
Autrement dit, nos croyances collectives forgent une vision commune qui nous permet d’avancer ensemble et de coopérer. Mais lorsque les croyances individuelles s’opposent dans un collectif, des tensions apparaissent et peuvent anéantir la coopération. Brian J. Robertson, fondateur de l’Holacratie, affirme que «la coopération émerge lorsque les tensions sont vues comme des signaux de croissance, et non comme des problèmes à éviter». Il souligne ainsi l’importance de leur gestion, car elles sont au cœur du modèle de gouvernance qu’il a développé. Les tensions naissent lorsqu’on perçoit un écart entre ce qui est et ce qui pourrait être mieux. Ce sont des besoins non satisfaits. Les ignorer ou les accumuler crée des conflits. Une équipe qui coopère cherche à répondre aux besoins collectifs de ses membres pour s’harmoniser et avancer vers une vision commune.
Pour cela, confiance et motivation sont deux indicateurs essentiels de la coopération. Ils dépendent eux-mêmes de la capacité des individus à traiter leurs propres tensions. Au niveau individuel, comment gérer ses tensions? Il faut un terreau propice: de l’autonomie, du droit à l’erreur, et des espaces de dialogue. Ainsi que des compétences relationnelles, pour donner et recevoir du feedback de qualité, s’adapter et se mettre au service du collectif. La coopération est la somme de la capacité des individus à coopérer.
L’agilité, de la coopération à grande échelle
Gérer les tensions au niveau organisationnel, c’est ce à quoi aspire l’agilité. Une organisation agile cherche à répondre aux besoins de toutes ses parties prenantes. Elle vise à articuler non seulement les besoins des équipes elles-mêmes, mais aussi les besoins transversaux et ceux des parties prenantes externes: les clients, les partenaires, la planète, etc. Dans un monde où la mondialisation et la technologie intensifient les interdépendances, les organisations doivent adopter une vision systémique. Une équipe performante, mais isolée dans une organisation en silos aura du mal à prospérer. Tout comme une entreprise qui adopte les formes de l’agilité (cercles, rôles, projets agiles) sans parvenir à instaurer une coopération réelle.
Ces interdépendances impactent fortement le rapport au temps. Là où la coopération s’inscrit dans la durée à travers la construction souvent lente de relations de confiance, l’agilité amène une volonté d’itération: les organisations testent, ajustent, réévaluent en permanence leurs pratiques à travers des cycles courts. Cela ne signifie pas que l’agilité est une approche à court terme, mais plutôt qu’elle cherche à assurer la pérennité en s’adaptant continuellement aux changements, plus fréquents aujourd’hui qu’à l’époque où la coopération s’est imposée comme nécessité.
Mais alors, par où commencer? Pour Frédéric Laloux, «l’agilité organisationnelle n’est pas une affaire de méthode, mais de qualité des relations. Et cela commence par la coopération.» Dans tous les cas, il est contre-productif de les dissocier ou de les opposer. Il ne s’agit pas de choisir une clé plutôt qu’une autre, mais plutôt d’envisager ces concepts comme des ensembles de clés appartenant au même trousseau. Encore faut-il que leur valeur et leur complémentarité soient reconnues.
L’agilité, un principe en devenir
Malgré son intention louable et ambitieuse, l’agilité ne bénéficie pas du même consensus que la coopération. Elle est citée partout, mais reste incomprise et source de tensions. Plusieurs raisons expliquent ce décalage. D’abord, l’étymologie du mot, qui renvoie à la facilité de mouvement, ne traduit pas la profondeur du concept. Cette connotation entre en contradiction avec les efforts considérables nécessaires pour mettre en œuvre l’agilité.
Ensuite, l’agilité souffre de nombreuses croyances réductrices: méthode, modèle, idéologie... Il n’existe pas encore de vision commune de ce qu’est l’agilité ni de réelle reconnaissance du besoin des organisations à s’adapter pour prospérer. Et pourtant, ce besoin d’adaptation n’est pas nouveau. Bien avant la popularisation du terme, les entreprises ont dû faire preuve d’agilité. Présenter l’agilité comme une innovation de rupture est une construction marketing, déjà en perte d’efficacité. On ne parle jamais de «transformation coopérative», tout comme on ne reproche pas à la coopération d’être floue. L’agilité doit encore mûrir. Néanmoins, ce que révèle son émergence récente, c’est certainement notre incapacité inédite à nous adapter. Au même titre que l’émergence de la durabilité, symbole de la prise de conscience récente de notre incapacité à assurer un avenir viable.
Plus que des mots, la coopération et l’agilité poursuivent une même quête: celle de la stabilité dynamique qui permet de durer dans un monde en mouvement. À l’image de l’homéostasie, ce mécanisme qui maintient l’équilibre du vivant, nos organisations ont besoin de structures souples, capables de s’ajuster en continu. Ces concepts, définitivement imbriqués, nous invitent à voir le monde autrement, avec plus de complexité, dans l’espoir de mieux nous harmoniser pour prospérer. Il appartient à chaque individu de considérer cette invitation. C’est peut-être là que réside la toute première clé: dans la capacité à communiquer une vision qui inclut chacun et rassemble le plus grand nombre.