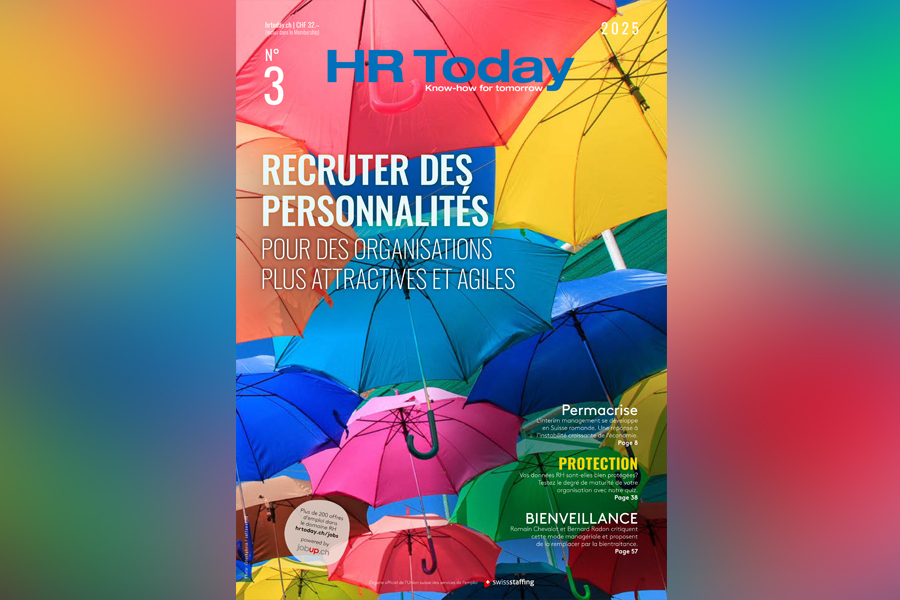Du crapaud qui peine à devenir prince
Nous connaissons tous et toutes l’histoire du crapaud qui, embrassé par une princesse, se transforme en prince. Certains assument d’ailleurs que tout crapaud, embrassé par la bonne personne, devient un prince.

Photo: Laura Seaman / Unsplash
De la mare caillouteuse aux plus hautes sphères du pouvoir, n’y a-t-il pas là matière à réflexion sur l’accès aux postes de management en entreprise? Bien sûr, les princesses ne sont plus très présentes – le temps où un bon mariage permettait parfois d’accéder à meilleure fortune semble révolu. Depuis quelques décennies, la dot à apporter n’est plus patrimoniale ou financière. Elle est une valeur immatérielle, tellement immatérielle que son nom même reste à peine compréhensible. Oui, je pense aux fameux acronymes CAS, DAS, MAS, MBA, eMBA.
Là où les babyboomers ont fait des carrières internes, les générations suivantes ont vécu la démocratisation des études, l’accès à une formation tertiaire initiale pour une part toujours plus élevée de la population. Du plateau suisse marécageux où les crapauds se sentaient à l’aise dans les métiers du secteur primaire et secondaire, l’environnement s’est mué en périphéries à l’urbanisation galopante. Les métiers ont muté vers le secteur des services en expansion infinie. Et ici, les princes sont demandés à tous les échelons.
Cette nouvelle hiérarchie semble en difficulté, et facilement accusée de management toxique. Et si se cachait derrière ce malaise un syndrome de l’usurpateur? (Syndrome différent de celui de l’imposteur en ce qu’il touche au pouvoir – à ma connaissance non référencé dans la littérature à ce jour) Et si cela n’était pas tant lié aux personnes qu’à l’évolution si rapide de la société? Le manager d’aujourd’hui ne se sentirait pas légitime à accéder au rôle et exercer le pouvoir qui lui est confié, au vu de son histoire familiale. En manque de confiance, il peinerait à assumer son niveau de fonction, sa posture, ses attributs de pouvoir et d’autorité avec assertivité.
Je m’inspire de Vincent de Gaulejac («L’Histoire en héritage, roman familial et trajectoire sociale», Payot 2012) et fais l’hypothèse d’une loyauté intergénérationnelle interrompue, au-delà des destins individuels, par la démocratisation des études et l’ascenseur social. Le fils, la fille, se retrouve ainsi non seulement mieux formée, plus diplômée, mais également d’une autre classe sociale, en tant que manager.
Vide intérieur
Que faire alors, une fois le Graal de la carrière obtenu à prix fort de formation continue, avec ce malaise inconscient à endosser l’habit du prince? Celui qui peine à se reconnaître dans le rôle par lui-même attendra la reconnaissance d’autrui pour y pallier. Il imposera d’être reconnu sans failles, nourrira son narcissisme de l’extérieur, et s’imperméabilisera contre toute critique, feedback. Il se gonflera comme le crapaud, pour prendre l’espace, le volume du poste, toutefois un peu vide à l’intérieur. Dans la nature, les animaux mâles le font pour séduire, les animaux femelles à des fins défensives.
Ce besoin d’impressionner a quelques impacts négatifs, sur les collègues et collaborateurs d’une part, sur soi-même d’autre part. Il est évident que l’on s’éloigne d’un leadership authentique, et que la transparence en prend un coup.
Vincent de Gaulejac aborde la réécriture de son histoire personnelle et familiale au travers des mutations sociétales. Conscientiser ses appartenances et sortir de cette dissonance intérieure pourrait permettre de sortir du syndrome de l’usurpateur et mener à l’avènement d’un management heureux.
À l’inverse, rester pris dans ses filets pourrait mener à quelques déviances, au-delà de sa propre réalité. Je nommerais l’enfant-roi, fils de l’usurpateur, dont les parents supposent inconsciemment qu’il les dépassera à son tour et mérite d’autres attentions dès son plus jeune âge. Ou l’extension nouvelle de la manosphère (un masculinisme exacerbé) par mutation génétique du crapaud ne parvenant à devenir prince charmant.