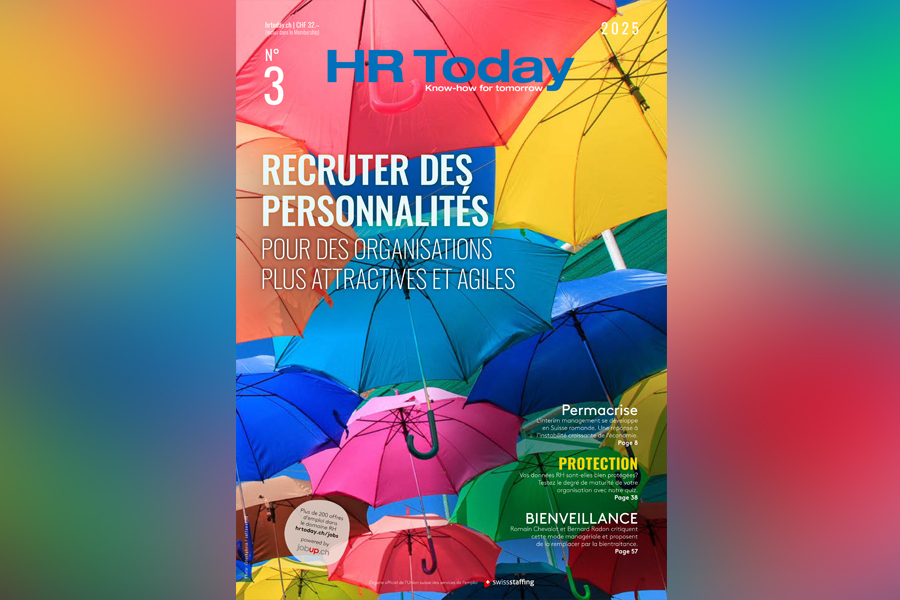Évaluer, choisir, accompagner: le rôle stratégique de l'assessment center
Évaluer le savoir-être d'un candidat permet de le projeter dans la réalité culturelle de l'organisation et de mesurer son potentiel. Voici un guide pratique pour structurer vos évaluations et sécuriser vos décisions de recrutement.

Photo: iStock
«Nous aimerions savoir comment le candidat réagirait si son supérieur lançait une agrafeuse à travers la pièce.» Derrière cette provocation formulée par un client, se cachait une question centrale: comment s’assurer qu’un candidat adoptera, dans un contexte donné, les comportements attendus par l’entreprise?
Évaluer un candidat lors d’un processus de recrutement ne se résume pas à vérifier son expérience ou ses savoir-faire techniques. Il s’agit de le projeter dans une réalité culturelle précise, avec ses codes, ses ambiguïtés et parfois ses tensions. Autrement dit, au-delà du savoir-faire, le savoir-être devient un critère central de réussite.
Clarifier les attentes comportementales
Les attentes liées au savoir-être, parfois exprimées sous des termes aux contours flous comme «leader charismatique» ou «esprit agile», peuvent recouvrir des interprétations très différentes selon les décideurs et recruteurs. Sans clarification, chacun projette ses propres critères et des désalignements apparaissent. Par exemple, selon le registre, un «bon communiquant» peut désigner quelqu’un qui crée une relation authentique et de confiance avec les équipes de terrain, mais peut aussi s’appliquer à un expert de la communication formelle capable d’influencer dans un environnement politique complexe.
Il est donc nécessaire, en amont, de traduire ces attentes en comportements observables, en adéquation avec le rôle et la culture. Comment devrait se manifester le leadership dans cet environnement? Quels signes tangibles permettent de juger de l’aisance relationnelle ou de la capacité d’anticipation, telle qu’elle est requise dans ce contexte précis?
Conseil: Formalisez un référentiel de compétences partagé, en explicitant les traits recherchés et les valeurs de l’entreprise sous forme de comportements observables et mesurables, adaptés au contexte du poste. Cette démarche favorise une évaluation plus objective, aligne les parties prenantes sur des critères clairs et renforce la qualité des décisions tout au long du processus.
De l’analyse à la mobilisation du potentiel
Lors de l’évaluation d’un candidat, il est essentiel de distinguer les compétences techniques — souvent acquises par la formation ou l’expérience — de celles, plus profondément enracinées, qui relèvent du registre comportemental, relationnel et émotionnel. Ces soft skills s’observent dans l’action: dans la manière de communiquer, de coopérer ou de s’adapter à l’imprévu par exemple. Elles ne sont pas figées, mais peuvent se développer dans un environnement qui favorise le feedback, la mise en pratique ou encore la progression continue, et pour autant que le candidat dispose d’un socle identitaire favorable: motivation à progresser, capacité d’introspection, ouverture au changement.
Cette aptitude à s’adapter et à évoluer peut constituer un véritable facteur différenciateur dans un processus de sélection. Le modèle de l’Iceberg (McClelland, 1973) illustre bien la dynamique selon laquelle les compétences visibles (connaissances apprises, savoir-faire) sont en surface, tandis que les ressorts plus profonds — valeurs, traits de personnalité, motivations — forment la base immergée, le socle identitaire. L’efficacité d’un Assessment Center (AC) réside notamment dans sa capacité à explorer cette partie invisible, pour évaluer non seulement ce que la personne est capable de faire et comment elle se comporte aujourd’hui, mais aussi le potentiel qu’elle peut déployer demain.
Prenons un exemple: deux candidats divisent les choix d’un comité de sélection. Le premier, très expérimenté, maîtrise les aspects techniques mais se montre rigide, peu à l’écoute du feedback. Son leadership repose sur le contrôle et l’application de méthodes issues d’expériences passées, sans réelle capacité d’ajustement. Le second, moins expérimenté, démontre une forte capacité d’écoute et de remise en question. Il accueille le feedback, mobilise ses interlocuteurs et s’adapte rapidement aux changements. Par sa curiosité, son intelligence relationnelle et sa motivation à progresser, il révèle un fort potentiel à long terme.
Conseil: En phase finale, identifiez ce qui relève du socle identitaire immuable du candidat, puis repérez les compétences à fort impact susceptibles d’évoluer. Vérifiez la capacité réelle de l’entreprise à les accompagner. En capitalisant sur les forces existantes, construisez un plan de développement ciblant des axes réalistes à renforcer. L’évaluation devient alors un levier stratégique d’intégration réussie et de performance durable.
Professionnaliser les assessments
Sous le mot «assessment» peuvent parfois se cacher des pratiques à la qualité très variable. Pour éviter les dérives méthodologiques, les interprétations biaisées ou les expériences dégradées, il est essentiel de clarifier, en amont, le niveau d’exigence attendu.
Un Assessment Center (AC) qualitatif repose notamment sur des principes reconnus et promus par Swiss Assessment, référence suisse en la matière: observation in vivo dans des mises en situation, croisement de méthodes (cas réalistes, jeux de rôle, outils psychométriques validés) et évaluation plurielle par des observateurs indépendants.
Conduit avec méthode et exigence, l’AC peut apporter une double valeur: une expérience enrichissante pour le candidat ainsi qu’un éclairage fiable sur celui-ci pour l’entreprise. Sa robustesse tient notamment à sa capacité à réduire les biais cognitifs et à renforcer l’objectivité des décisions.
Par exemple, lors d’un entretien classique, un candidat très extraverti et issu de la même école que le recruteur pourrait bénéficier simultanément de l’effet de halo (tendance à attribuer des qualités globales à partir d’un trait visible, comme l’aisance orale) et du biais de similarité (tendance à percevoir positivement ceux qui partagent des points communs avec soi). En Assessment Center, ces impressions initiales sont diluées: le candidat est observé dans plusieurs mises en situation par des évaluateurs indépendants qui notent les comportements selon une grille standardisée. Le recoupement des observations fait apparaître la performance réelle et neutralise ces biais.
Conseil: Renforcez l’objectivité de vos évaluations en vous appuyant sur un processus fiable et rigoureux. Formez vos évaluateurs aux biais cognitifs, observez les comportements en situation, diversifiez les données via des exercices variés, privilégiez l’évaluation croisée (principe des «quatre yeux») et veillez à une expérience candidat cohérente, renforçant votre marque employeur.
L’Assessment Center: voir plus loin que la sélection
En alliant l’exigence méthodologique et une compréhension fine des individus, l’AC est un puissant outil prédictif de la performance et de l’adéquation d’un candidat à une culture d’entreprise. Il peut amorcer un plan de développement individualisé, aligné sur les priorités de l’organisation comme sur le potentiel des candidats. Autrement dit, loin d’être une simple étape de sélection, l’Assessment Center est un outil qui transforme le recrutement en investissement durable dans la performance humaine.
Assessment Center de qualité
• Clarifier les objectifs: recrutement, promotion ou développement?
• Définir les comportements attendus: ancrés dans le rôle et la culture.
• Aligner les parties prenantes: critères, attentes et calendrier validé.
• Choisir des outils adaptés: méthodes validées, exercices variés.
• Former les évaluateurs: objectivité, maîtrise des biais, regards croisés.
• Soigner l’expérience candidat: cadre clair, respectueux et engageant.
• Prévoir la suite: plan de développement et opportunités d’accompagnement.