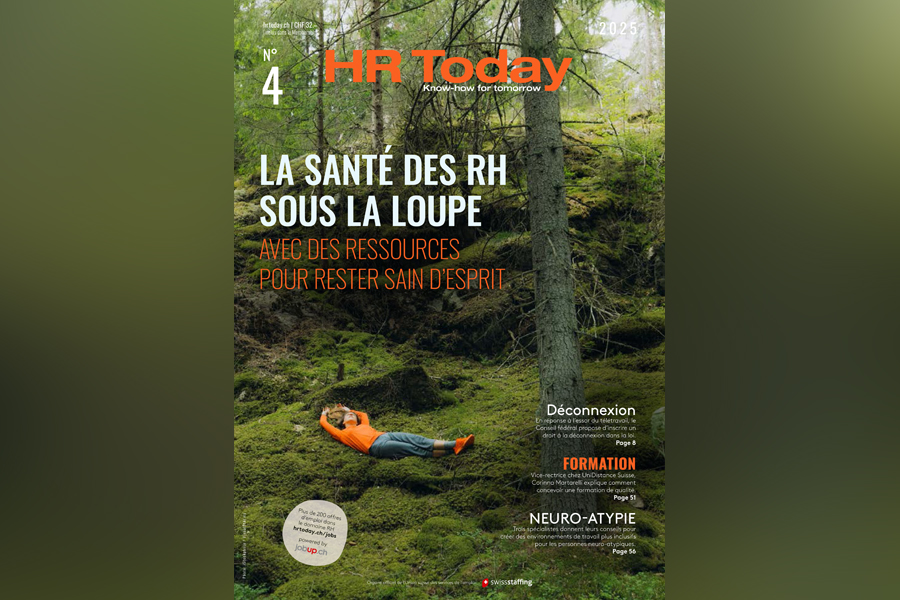Faut-il un droit à la déconnexion?
En réponse à l’essor du télétravail et de l’hyperconnectivité, le Conseil fédéral propose d’inscrire un droit à la déconnexion dans la loi. Une position qui divise tant les employeurs que les syndicats.

Photo: iStock
Ne pas être joignable en dehors de son temps de travail, par exemple le soir, le week-end ou pendant les vacances, sans subir de pressions ou de conséquences professionnelles. Voilà l’idée du droit à la déconnexion. Un principe qui pourrait bientôt être inscrit dans la loi suisse. En effet, le Conseil fédéral a approuvé fin mai un projet législatif visant à assouplir les règles du temps de travail et de repos, notamment dans le cadre du télétravail, en y ajoutant un droit à la déconnexion. Le projet fait suite à une initiative parlementaire du conseiller aux États argovien Thierry Burkart portant sur la flexibilisation du télétravail.
Flexibilité accrue
Le texte soutenu par le Conseil fédéral prévoit notamment d’étendre la durée maximale de la journée de travail à 17 heures (contre 14 aujourd’hui), de réduire la durée minimale de repos de 11 à 9 heures, et d’autoriser le travail dominical, jusqu’à six fois par an sur base volontaire, avec compensation. En contrepartie, le projet introduit explicitement un droit à la déconnexion, en reconnaissant le droit de ne pas être joignable pendant les périodes de repos et le dimanche. Ce droit ne s’appliquerait pas uniquement aux télétravailleurs, mais à tous les salariés. Le Conseil fédéral propose même de l’inscrire également dans le Code des obligations, ce qui renforcerait sa portée symbolique et juridique.
Ce virage du gouvernement, qui avait précédemment rejeté plusieurs objets similaires déposés au parlement, suscite des réactions contrastées de la part des partenaires sociaux. «Le Conseil fédéral avait mentionné que des limites légales claires et suffisantes à la joignabilité permanente existaient déjà, explique ainsi Marco Taddei, responsable romand de l’Union patronale suisse (UPS), dans le journal «Le Temps». Nous sommes d’avis qu’une précision serait superflue.»
Droit négatif
Même incompréhension du côté des syndicats. «Le projet donne l’illusion d’un progrès, alors qu’il ne fait que consacrer des droits déjà existants sans apporter de véritable avancée, souligne Luca Cirigliano, secrétaire central de l’Union syndicale suisse (USS). Le travail de nuit, le dimanche ou durant les pauses est interdit, donc l’employeur n’a pas le droit de vous solliciter à ces moments-là.»
Et de relever que cette nouvelle disposition n’impose aucune obligation à l’employeur. «Le salarié a le ‘droit’ de ne pas consulter ses messages, mais rien n’interdit à son supérieur de lui envoyer des e-mails, des messages WhatsApp ou de l’appeler pendant ses temps de repos. Un véritable droit à la déconnexion devrait interdire à l’employeur de prendre contact avec son personnel en dehors des horaires de travail.» Le responsable syndical estime que la réception même d’un message professionnel hors temps de travail génère une pression. «C’est une forme d’auto-mise en danger, comme l’ont montré de nombreuses études en psychologie du travail.»
Exemples européens
La Suisse n’est pas le seul pays à se pencher sur la question. La France s’est illustrée comme pionnière, en inscrivant en 2017 un droit à la déconnexion dans son Code du travail. Les entreprises de plus de 50 salariés doivent depuis négocier des modalités qui garantissent le respect des temps de repos. En Espagne et en Italie, des dispositifs similaires existent depuis 2018. L’Allemagne mise pour sa part sur des accords internes. Certaines entreprises comme le constructeur automobile Volkswagen ou le fabricant de détergents Henkel désactivent les serveurs de messagerie en dehors des heures de travail ou lors de certains jours de la semaine. À l’échelle européenne, une directive sur le droit à la déconnexion est en discussion depuis 2021. Elle vise à interdire explicitement aux employeurs de contacter leurs salariés en dehors du temps de travail, sauf circonstances exceptionnelles. Certaines pratiques de ce type existent déjà en Suisse: des grandes entreprises bloquent l’accès aux messageries professionnelles après 21h30 ou 22h.
Fin juin, la Commission de l’économie et des redevances du Conseil national a majoritairement approuvé les adaptations proposées par le Conseil fédéral concernant son projet d’assouplissement du télétravail. Elle accepte notamment que le droit de ne pas être joignable s’applique à tous les travailleurs, et non uniquement à ceux en télétravail, ainsi que la limitation du champ d’application aux adultes disposant d’une certaine autonomie dans la gestion de leur temps de travail. Elle renonce aussi à l’obligation d’une convention écrite entre employeur et employé. En revanche, elle maintient sa volonté de réglementer le télétravail uniquement dans la loi sur le travail, sans l’étendre au Code des obligations. Le projet sera examiné par le Conseil national lors de la session d’automne.
Paradoxe de la déconnexion
Une étude réalisée aux États-Unis met en lumière un phénomène troublant: bien que les managers reconnaissent l’importance de la déconnexion pour le bien-être et la performance de leurs collaborateurs, ils ont tendance à pénaliser ceux qui la pratiquent réellement au moment de décider d’une promotion. Ce «detachment paradox» reflète une tension entre les discours favorables à l’équilibre vie-travail et des attentes implicites de disponibilité permanente, soulignent les auteurs de l’étude.
En Suisse aussi, certains employés relatent ce double discours, indique Luca Cirigliano, secrétaire central de l’USS. «On les encourage à se préserver, tout en valorisant les comportements de surengagement. Ce phénomène pourrait encore s’accentuer avec le nouveau projet de loi. Du moment que l’employeur a le droit de vous écrire en dehors des horaires, il attendra que vous soyez disponible. » Un phénomène aggravé par le BYOD (bring your own device), estime le responsable syndical. «Beaucoup utilisent leur téléphone personnel à des fins professionnelles, avec un numéro unique, parfois mis à disposition par l’employeur. Mais cette offre gratuite peut devenir un piège, car l’on est alors joignable à toute heure.»