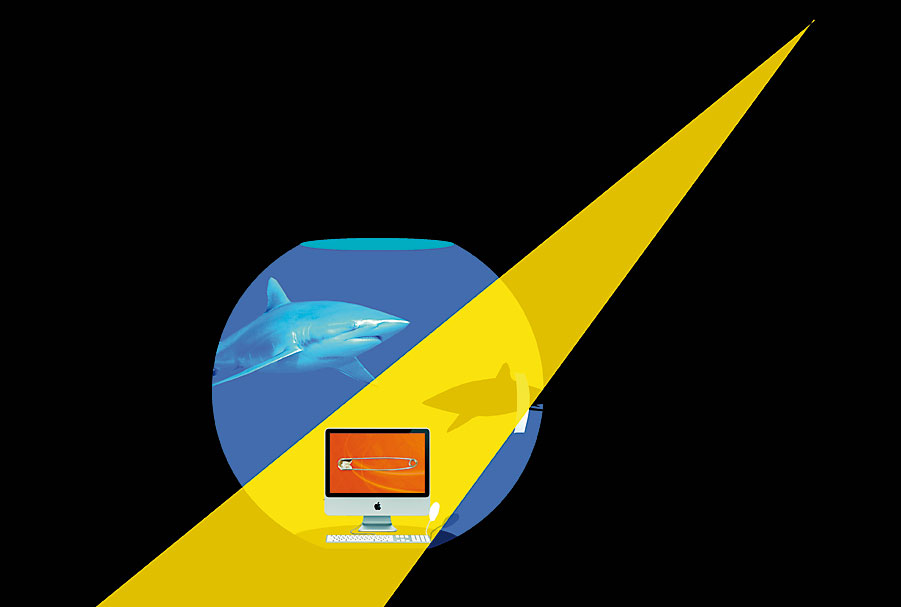Les pratiques contestées de surveillance des collaborateurs
Appeler son chef pour dénoncer un comportement frauduleux dans l’entreprise pose plusieurs problèmes juridiques et éthiques. L’élaboration de programmes de «whistleblowing» concerne sutout les grandes entreprises. Et le processus a intérêt à être bien ficelé pour qu’il livre les résultats escomptés.

Le «whistleblower» dérange. Et on ne préfère pas l’évoquer en public. Plusieurs sociétés établies en Suisse romande qui recourent aux «whistleblowers» ont poliment refusé de participer à cet article. Préférant botter en touche ce sujet délicat. Alors qui sont ces «whistleblowers» dont personne ne veut parler? Il s’agit d’employés dont l’unique cahier des charges est de surveiller les autres collaborateurs de l’entreprise. Le terme est anglo-saxon et peut se traduire par «celui qui tire la sonnette d’alarme». Mais le «whistleblowing» peut aussi être appliqué à toute l’organisation. En instaurant des hotlines confidentielles pour ceux ou celles qui désireraient faire part de leurs soupçons. Selon nos informations, l’élaboration de vrais processus de «whistlebloing» est plutôt récente en Suisse romande mais serait en train de se développer fortement. Elle concerne avant tout les grandes organisations, dans lesquelles la taille des effectifs rend plus difficile la surveillance. Le phénomène touche donc surtout les multinationales et les grands établissements bancaires et financiers, deux secteurs particulièrement sensibles au «risk management». Sur le papier, l’objectif d’un programme de «whistleblowing» est de garantir la qualité des services offerts et de soigner l’image de la maison. Mais le processus est également utile en terme de gestion de la sécurité. Car il permet de garder un œil sur les potentiels comportements illicites dans l’organisation (fraudes, corruption, délit d’initié, menaces). Et comme ces failles sont très souvent humaines, surveiller discrètement les collaborateurs devient une source importante d’informations pour les responsables de la sécurité.
Preuve que la pratique intéresse de plus en plus les organisations, une étude sur le sujet vient d’être publiée par le cabinet d’audit Ernst & Young*. Menée à l’échelon européen (y compris en Suisse), sur un échantillon de 1300 collaborateurs actifs dans des multinationales, l’étude a révélé un écart considérable entre ce que les employés estiment être une bonne politique de surveillance et la perception qu’ils ont des programmes en place dans leurs organisations. En clair, les sondés approuvent les mesures anti-fraudes et les programmes de surveillance détaillés. Car ils admettent que les risques de mauvaises conduites sont bien réels. Mais ils restent sceptiques devant les méthodes qui sont appliquées sur leur propre place de travail. Pour réduire cet écart entre l’idéal et la perception qu’ils ont de la réalité, ils exigent des codes de conduite clairs. Et insistent aussi sur la nécessité d’avoir des canaux de plaintes très sécurisés. L’étude révèle aussi des fortes attentes éthiques quant aux processus d’investigation mis en place pour vérifier la véracité des dysfonctionnements dénoncés.
Dans la pratique, les programmes de surveillance des collaborateurs gagnent donc à être soigneusement élaborés avant d’être appliqués. Le processus démarre en général avec la rédaction d’un code éthique. En Suisse, environ 70 pour cent des sondés confirment qu’un code de conduite existe dans leurs organisations. Ce qui est plus haut que la moyenne (50 pour cent). Quant au contenu de ces codes, ils devraient énumérer les bons comportements plutôt que les mauvais. Et le fait de dénoncer un collègue fraudeur est considéré comme un acte «juste».
La perception des «whistleblowers» demeure cependant mitigée. Et la protection des dénonciateurs (juridiquement et dans les réglements d’entreprise) est controversée. Le risque étant de protéger un «whistlblower» malhonnête. Car si l’objectif avoué d’un plan de surveillance est de garantir une bonne éthique des affaires, les canaux de dénonciations peuvent aussi être employés à des fins stratégiques et personnelles (la promotion de carrière). Et jeter des soupçons sur un collègue devient aisé si l’anonymat est garanti. Dans la pratique, il n’y a pas vraiment de solutions à ce problème. Car rien ne pourra empêcher les coups bas. Et certains diront même qu’ils font partie de la vie en entreprise.
La très grande majorité des sondés (94 pour cent) estiment cependant que le dénonciateur doit être protégé. Et c’est là que tout se complique. Car garantir des canaux sécurisés et anonymes n’est pas une mince affaire. La législation en la matière est encore lacunaire. Et le législateur hésite encore à poser un cadre clair pour autoriser la pratique du «whistleblowing», estiment les auteurs de l’étude. En Suisse, la loi sur la protection des données donne quelques pistes. En principe, un employé doit être informé qu’une enquête est en cours contre lui. Il doit pouvoir accéder aux informations récoltées pour qu’il puisse y apporter, le cas échéant, sa version des faits. La ligne entre le dénonciateur, qui désire à tout prix rester anonyme, et le dénoncé, qui est en droit de savoir ce qu’on lui reproche, est donc très fine. Et c’est bien sur ce point que buttent encore bon nombre d’organisations. Ici encore, les chercheurs estiment que la clarté du processus sera déterminante pour résoudre l’énigme.
L’étude montre également que 84 pour cent des sondés hésitent à dénoncer une fraude si elle peut nuire à un collègue. Alors qu’ils ne sont que 61 pour cent quand c’est le supérieur qui est menacé. Autre résultat intéressant: un classement des positions hiérarchiques vers lesquelles les collaborateurs se tourneraient en cas de dénonciation. Dans l’ordre de préférence, on trouve le supérieur direct (qui récolte 73 pour cent des suffrages), le top management (55 pour cent), le médiateur (47 pour cent), le middle management (44 pour cent), le responsable RH (43 pour cent), une hotline (30 pour cent), un collègue (29 pour cent), une hotline sur le web (26 pour cent), personne (20 pour cent), la police (20 pour cent) et enfin le suspect lui-même (4 pour cent). A relever que les ressources humaines pointent seulement en cinquième position au niveau européen mais passent en troisième position en Suisse.
Mais la partie la plus délicate du processus est sans aucun doute l’investigation. Enquêter sur un employé pose une série de problèmes en termes de protection des données. La première phase de l’enquête (jusqu’à ce que le soupçon soit vérifié par des preuves) doit être effectuée dans une stricte confidentialité. Une fois cette première étape terminée, pour des raisons juridiques et éthiques, il est fortement conseillé d’informer la personne suspectée. Cela augmentera considérablement la qualité de l’enquête. Et peut être une source d’informations importante en cas de refus. Au contraire, enquêter sur un collaborateur en coulisse est très mal vu par les sondés. En Suisse, 82 pour cent d’entre eux le désaprouvent.