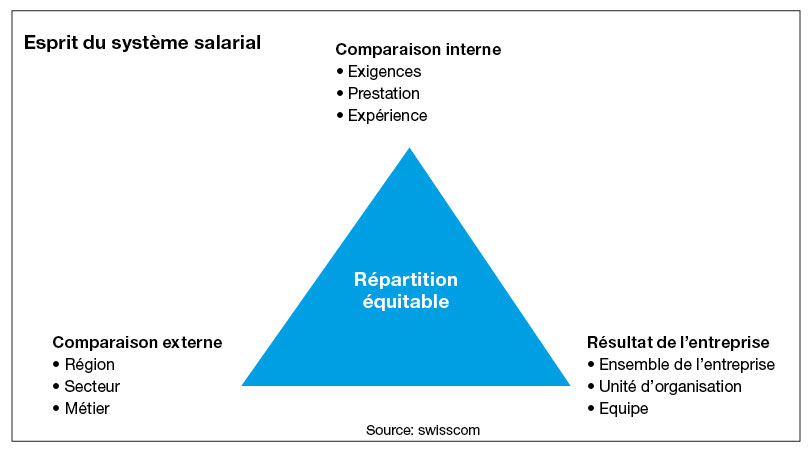"C’est au DRH d’introduire la notion de responsabilité au sein de l’entreprise»"
L’économiste Paul Dembinski dirige l’Observatoire de la finance et enseigne à l’Université de Fribourg. Spécialiste reconnu des questions éthiques liées à la finance, il livre ici son analyse des affrontements violents vus en France; évoque le rôle des RH et plaide pour plus de responsabilité dans la conduite des affaires.

Photo: Olivier Vogelsang/disvoir.net
En France, des salariés retiennent contre leur gré des membres de la direction de leur entreprise, d'autres menacent de faire sauter les bâtiments si le patron délocalise la société. Comment interprétez-vous ces violentes réactions?
Paul Dembinski: C'est le signe d'une tension sociale qui prend son origine souvent dans l'entreprise même, mais dont la source peut aussi être à l'extérieur de l'entreprise. Celle-ci devient alors un terrain d'affrontement. Nous observons un indéniable durcissement du climat psychosocial. On le constate avec le véritable «scandale» des bonus qui ont suscité de très fortes réactions au sein de la population. Ce phénomène de surenchère participe aussi à la dégradation des relations dans les entreprises. Il est assez évident que ces tensions dont vous parlez traduisent une angoisse certaine d'une bonne partie des employés, et notamment dans les entreprises dirigées depuis l'autre bout du monde.
Pourquoi?
Parce que les collaborateurs ont le sentiment d'être instrumentalisés et parfois tout simplement jetés à la fin du cycle d'une entreprise. Cela s'appelle la «chosification» des personnes. C'est le propre de l'aliénation: on se sent en dehors de ce que l'on fait parce qu'on ne le comprend pas et on ne le maîtrise pas. Un sentiment ressenti le plus souvent dans les usines, mais également présent dans des activités de services. Cette crainte d'aliénation peut parfois être adoucie par un chèque substantiel à la fin du mois, mais lorsque ce facteur argent est absent ou inopérant, on peut assister à des actes extrêmes de bossnapping comme en France.
Ce sujet d‘actualité semble révéler un sentiment d‘injustice de plus en plus exacerbé. Peut-on s'attendre à un phénomène comparable en Suisse?
Je ne dirai pas «injustice» mais plutôt «incompréhension». Le sentiment de ne pas être considéré comme un partenaire, mais comme un pion dont l'autre peut se débarrasser facilement. D'où un ressentiment que je trouve légitime. Et je ne vois pas pourquoi notre pays serait épargné. D'ailleurs, ces points de tension physique se sont déjà exprimés en Suisse. Que ce soit lors du conflit Swissmetal à la Boillat ou durant la grève chez CFF Cargo au Tessin. C'est un signe des temps caractéristique de la «chosification» de la personne. Je pense que ces durcissements apparaissent dans des centres de production où la direction est très éloignée des préoccupations locales. L'entreprise c'est un lieu de partenariat, de communication. Une fois que l'on rentre dans une spirale de méfiance et d'incompréhension mutuelle, le geste ultime devient irrationnel.
Dans un de vos ouvrages, vous écrivez qu'aujourd‘hui, les sondages internes, les études et les nouvelles convergent pour indiquer que le degré des tensions humaines dans le monde de l‘entreprise atteint des niveaux inégalés: surcharge de travail, interférences entre le temps professionnel et le temps privé, incertitudes liées à l‘emploi, mobbing. Expliquez-nous.
J'ai l'impression que le travail est comme un récipient fissuré. Jusqu‘en 1970, le travail était cantonné dans l'espace et le temps. A partir des années 1980, c'est la dislocation du temps. Le travail ne s'arrête pour ainsi dire jamais. A ce propos, une chose m'a toujours frappé: le lien entre travail et vie privée est aujourd'hui tellement imbriqué que vos collègues sont devenus à la fois des relations de travail, mais aussi des relations amicales. Ils ne sont pas vraiment des amis et plus totalement de simples collègues. Un vrai flou artistique. C'est pour moi très significatif. On demande tellement aux collaborateurs: d'être innovateur, proactif, compétitif, et souriant si possible. La distinction entre vie privée et professionnelle devient plus difficile. Résultat? En situations de crise ou d'incompréhension sur la stratégie d'entreprise, cela conduit souvent à une radicalisation des rapports au sein des entreprises.
L'Observatoire de la Finance, que vous dirigez, propose un service original: répondre aux interrogations et préoccupations éthiques que vous soumettent des salariés.
L'«Echo de l'éthique»* est né d'une discussion autour d'un livre de l'ethnologue Alain de Vulpian intitulé: «A l'écoute des gens ordinaires». Il montre l'importance des micros décisions. Un contre-pied à l'idée que les grandes décisions éthiques se prennent uniquement lors de réunions du G20, par les gouvernements et les parlements. En réalité, l'éthique sociale ne résout pas tout, il faut que la dimension éthique s'épanouisse aussi dans les micros décisions. Du coup, nous avons lancé un appel public pour que des salariés ou des patrons soumettent à un panel de professionnels de tout horizon, des situations où ils pensent avoir été confrontés à un dilemme éthique. Le but n'est pas de résoudre la situation proposée, mais d'essayer de structurer le questionnement éthique. Où sont les enjeux, comment y faire face au sein de l'entreprise? L'«Echo de l'éthique» montre que dans des situations parfois banales peuvent se cacher des enjeux éthiques d'importance.
Au sein des entreprises, il existe souvent une charte éthique ou un code de bonne conduite. Comment procéder pour le faire respecter?
Le plus important avec la charte éthique, c'est la manière dont elle est élaborée, et non pas comment elle est appliquée. On peut en acheter à des consultants extérieurs, en télécharger sur internet... Mais cela ne fait pas de sens. C'est même une absurdité. Un code éthique doit être vivant et partagé. Un savant équilibre entre les instances dirigeantes et les collaborateurs. Ce n'est évidemment pas facile à élaborer et il implique parfois que la direction se remette en question. Le pire ce sont les codes éthiques bricolés et artificiels. Je constate que beaucoup d'entreprises ont de la peine à ouvrir une discussion sur l'éthique.
Pourquoi?
L'élaboration d'un tel code est chronophage, il ne faut pas se le cacher. Mais le thème des valeurs propres à l'entreprise est primordial. Le souci du résultat, le souci de la règle interne ou externe, c'est bien. Tout comme la question de la qualité de ce que je fais: il y a des choses qu'un bon professionnel - que ce soit dans la finance ou dans n'importe quel autre emploi - ne s'autorise pas à faire. Cette question éthique ne doit pas être un tabou. C'est, je crois, au DRH d'insister pour introduire au sein de l'entreprise la notion de responsabilité. Un manager d'une grande banque de la place genevoise m'a dit un jour: «J'ai besoin de collaborateurs qui obéissent, pas de collaborateurs qui pensent...». Ces entreprises-là n'ont pas d'avenir. Elles préfèrent acheter une conscience avec des bonus que de se poser la question de l'éthique. Je pense que les entreprises de services, proches du client, ont un devoir moral de se poser la question de l'éthique. Une réflexion éthique peut amener à renoncer à une affaire douteuse. C'est le prix à payer.
Certains objecteront qu'éthique et compétitivité sont incompatibles...
D'une part, le terme de compétitivité est d'un flou absolu. D'autre part, parmi les nombreuses entreprises en faillite que j'ai eu l'occasion d'analyser, ce n'est assurément pas un excès de vertu qui explique leur disparition... Certains se disent: si on ne prend pas cette affaire, d'autres la feront à notre place... Autant rayer toute idée de moralité des affaires! Je ne crois pas à deux choses: au discours bêtifiant qui prétend que l'éthique conduit nécessairement au succès. Non, c'est un risque qu'il faut prendre et assumer. Et je ne pense pas non plus que l'éthique tue l'entreprise, tue la performance. Qu'on le veuille ou non, l'éthique est présente dans un très grand nombre de décisions. C'est une dimension que l'on étouffe, que l'on ne veut surtout pas voir.
Comment réagissent vos étudiants?
Au début du cours, ils sont un peu ébahis que l'on puisse se poser la question de l'éthique dans des études d'économie ou de gestion. Puis, ils changent d'avis et s'interrogent: pourquoi ce thème n'a-t-il pas été abordé plus tôt dans leur cursus? Certains me disent - des années après - que s'ils ne s'étaient pas intéressés à cette question, ils ne seraient aujourd'hui que des rouages d'un système, d'un processus bien rodé. A ceux qui doutent de l'intérêt d'un tel cours, ma réponse est invariablement la même: il suffit de relire les livres d'histoire. Il n'y a pas si longtemps, au cœur de l'Europe, un système - voire deux - de funeste mémoire, était entièrement basé sur l'idée que l'éthique et la technique étaient disjointes. L'attitude: «pas de questionnement, pas de responsabilité, pas de problème» me paraît incompatible avec la dignité humaine et d'autant plus à Genève où l'on plaide le respect des droits de l'homme. Il me semble qu'il faut ramener ces considérations au niveau de l'entreprise. Dans un ouvrage fameux «Managers not MBAs» publié en 2004, Henri Mintzberg écrivait déjà que les managers sont mal formés et ne font qu'appliquer des schémas obsolètes, et que du coup la catastrophe n'était pas très loin. Paroles prémonitoires. En matière de catastrophe, on y est.
Alors, qu'est-ce qu'une entreprise doit entreprendre pour développer une éthique plus forte?
Les cadres ont une grande responsabilité. Sans parler des Universités et des hautes écoles de gestion. Elles sont malheureusement devenues des centres de formatage. Heureusement, le «matériel» - l'homme - n'est pas totalement malléable. A un moment donné, il se rebiffe. Enfin, à mon sens, les seniors ont le devoir de transmettre aux plus jeunes des questions et des interrogations sur le fonctionnement du monde des affaires.