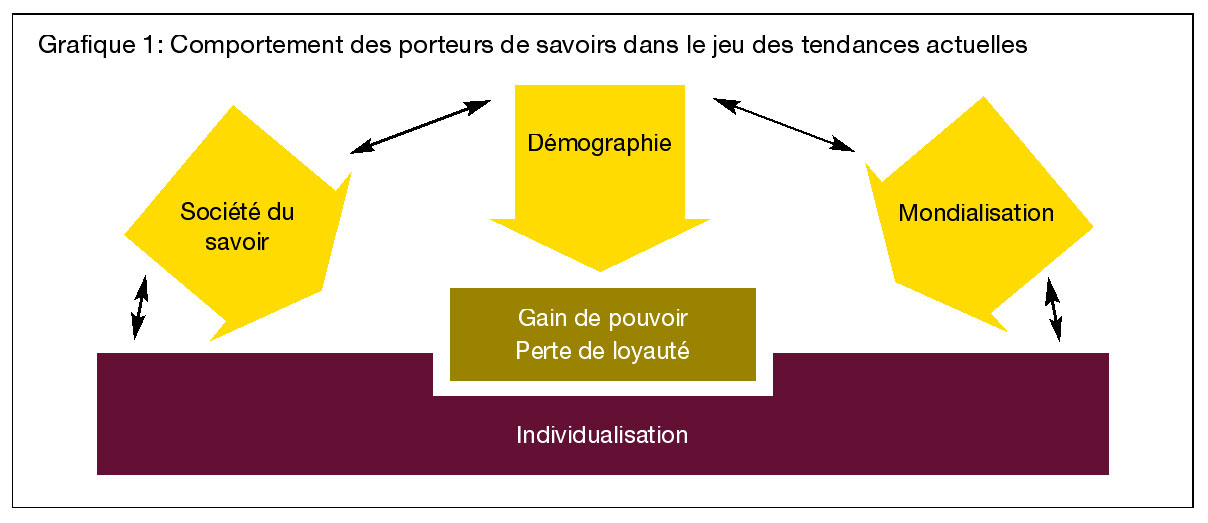La fidélisation est aujourd’hui une question typiquement suisse
On a beaucoup parlé, ces quinze dernières années, de la mobilité comme caractéristique des carrières professionnelles. Pourtant, en Suisse, aujourd’hui, un discours de fidélisation des collaborateurs se fait entendre. A cause notamment de la pénurie de main-d’œuvre et de la chasse aux talents.

Mathilde Bourrier. Photo: Olivier Vogelsang
Rencontre avec deux sociologues françaises de l’Université de Genève pour une analyse des rapports qu’entretiennent les hommes et les femmes avec le travail, les entreprises, la mobilité, la fidélité et la motivation. Deux regards qui pointent également les fortes différences entre les marchés du travail suisse et français aujourd’hui.
HR Today: On lit souvent que les travailleurs se sont adaptés à la mobilité professionnelle. Est-ce vraiment le cas?
Mathilde Bourrier: Je pense qu’on peut dire que plus les niveaux de formation sont élevés et plus la mobilité est choisie plutôt que subie. La mobilité fait même partie d’une forme de réussite sociale. Mais la mobilité est vécue très différemment par les gens des couches plus modestes qui n’ont pas forcément les moyens de racheter une maison, de résilier un emprunt lorsqu’ils sont forcés de changer de travail.
Margaret Maruani: Nous sommes en tout cas dans un système où l’insertion professionnelle stable des jeunes prend de plus en plus de temps. Il y a une mobilité vertigineuse jusqu’à 30 ou 32 ans.
Les travailleurs sont-ils favorables à cette mobilité professionnelle?
MM: La mobilité géographique est une nécessité pour les cadres. C’est quasi un signe extérieur de réussite. Mais cette mobilité-là n’a rien à voir avec celle des ouvriers obligés de choisir entre le chômage et un changement de métier et de région… Ce n’est pas la même logique sociale qui est à l’œuvre. Et certains cadres qui n’en veulent absolument pas savent qu’ils sont obligés de passer par là.
MB: Il y a aussi des métiers particuliers, comme l’hôtellerie, dans lesquels la mobilité est un signe de réussite, une fierté pour ceux qui la vivent. Pour les cadres, je pense également qu’il y a une absorption très forte des normes sociales qui les conduit à dire qu’ils aiment la mobilité. Mais est-ce que les multinationales n’ont pas formaté ce désir de mobilité? Les deux mouvements sont présents. On ne peut pas réduire la question à des aspirations individuelles.
MM: Il y a également une façon de rationaliser a posteriori des choses qui sont imposées.
Aujourd’hui, en Suisse, on parle beaucoup de fidélisation. Parmi les facteurs avancés par les entreprises pour motiver leurs collaborateurs, on entend parler de l’identification aux valeurs de l’entreprise. Qu’en pensez-vous?
MM: Les valeurs d’entreprise ont des relents de mode d’organisation paternaliste. Si on veut faire croire cette fable aux gens, il faut du moins qu’il y ait les deux termes de l’échange: c’est-à-dire la fidélité assurée des deux côtés. Ce qui existe peut-être en Suisse dans un certain nombre de secteurs, ce qu’il y a de moins en moins en France.
MB: Il y a une problématique typiquement suisse dans cette question. La Suisse est dans une conjoncture d’énorme prospérité. Le capital humain y est donc très important. En France, le discours est: «Vous restez, vous êtes payés et si vous n’êtes pas contents, il y en a mille personnes qui attendent votre place.» Les valeurs de l’entreprise, c’était un discours très fort des années 80 et 90 en France. On a parlé d’identité d’entreprise et de culture d’entreprise dans une période de relative croissance. Le discours des valeurs cache tout le discours de la motivation: comment dire aux gens qu’ils sont dans l’endroit le plus merveilleux de la terre et que leur contribution est importante. En France – j’exagère un peu – on n’a même plus besoin de dire aux gens que leur contribution est importante.
MM: Quand la pression du chômage est omniprésente, la valeur principale, c’est d’avoir un emploi.
Pourquoi ce retour du discours sur les valeurs?
MM: C’est un discours de gestion des ressources humaines! Quant à l’idée de fidélisation, on ne peut plus y penser aujourd’hui en France.
MB: On y repensera.
Les travailleurs sont-ils devenus une denrée si rare pour qu’on parle de «retention management»?
MM: En Suisse, oui; en France, c’est l’emploi qui est rare. Les stratégies de fidélisation
existent en Suisse et ont existé en France à d’autres moments.
MB: On y repensera un jour en France. Mais le concept de «retention management» vient des business schools américaines et est à mon avis très peu présent en Europe.
Quels sont à vos yeux les critères importants de la motivation?
MM: Les gens sont surtout contents de toucher un salaire. Les conditions de travail, les conditions de salaire, la sécurité de l’emploi, tout cela compte également pour que les gens restent dans une entreprise.
MB: Les sociologues ont montré que les conditions salariales n’étaient pas tout. L’ambiance et le bien-être au travail comptent également. Mais cela pose aussi de nombreux problèmes aux salariés. Le bien-être, c’est résister au stress. De grandes sociétés proposent à leurs salariés des stages de «well being». Mais beaucoup de gens considèrent que ça culpabilise les individus. On ne parle plus des conditions de travail, on dit «vous, par rapport à votre comportement quotidien, comment pouvez-vous améliorer votre résistance aux conditions de travail.» Ça réindividualise beaucoup la question.
La sécurité de l’emploi reste-elle essentielle?
MM: Quand il y a pénurie de l’emploi, la question de la sécurité est cruciale. La mobilité en temps de pénurie est de plus en plus connotée péjorativement. Car c’est une mobilité qui n’est pas choisie. Mobilité, flexibilité, souplesse… La question est: «Pour qui? Qui choisit?» Pour beaucoup d’emplois que l’on dit flexibles, le retournement sémantique est incroyable: la flexibilité est d’une grande rigidité pour le salarié.
On lit souvent que le collaborateur doit être le gestionnaire de sa propre carrière…
MB: Est-ce que les gens y croient, est-ce qu’ils font croire qu’ils y croient?
Ces discours seraient donc créés de toutes pièces par les entreprises?
MB: Non, je crois que les gens ont besoin de croire à certaines choses. Ils sont acteurs du discours. Mais les cadres eux-mêmes ont parfois de la peine à y croire. En France, dans le livre «Bonjour paresse» (ndlr: grand succès de librairie), une ex-cadre d’EDF a écrit un pamphlet sur ce qui se passe parmi les cadres des grandes en-treprises autour de la novlangue. Elle conclut qu’il faut saboter l’entreprise. En France, il y a une extraordinaire méfiance vis-à-vis du discours de l’entreprise et des valeurs qu’elle porte, y compris chez les cadres.
MM: Sous l’effet de la pression des entreprises, il y a eu des mouvements curieux. Des études ont montré que des personnes travaillant dans le privé, même des cadres, n’en pouvant plus de la pression, passaient le concours de la fonction publique quitte à se déclasser salarialement. C’est une forme de mobilité inattendue.
Un travail pour toute une vie est donc une idée qui plaît encore?
MM: Il faut distinguer travail et emploi. L’idée de changer de travail ne pose certainement pas de grands problèmes. Mais il faut avoir un emploi toute sa vie.
Est-ce que certaines générations sont plus attachées que d’autres à garder le même travail?
MM: Non, je ne crois pas. En France, aujourd’hui, on a un problème de chômage massif. Mais le chômage a toujours existé. Ce qui déstabilise, c’est que, maintenant, ça vaut pour tout le monde: les ouvriers, les employés, les cadres.
MB: Je ne pense pas qu’il y ait un problème de génération. Il y a une illusion des Trente Glorieuses. Avant elles, les gens avaient plusieurs métiers en parallèle: ils étaient souvent ouvriers et agriculteurs, par exemple. Les Trente Glorieuses ont été une parenthèse bénie. Ça fait par ailleurs très longtemps qu’on dit que les employés vont connaître dix métiers dans leur vie. De fait, on n’en a pas vu beaucoup. On n’a pas mis beaucoup de moyens pour la formation continue. En période d’emploi rare, on remplace les gens peu formés par d’autres mieux formés. J’ai en tête la scène d’un film où un directeur d’usine dit «Vous savez, on va sur les marchés chinois, on va devoir beaucoup bouger, on va devoir vous faire changer vos modes de fonctionnement et même si ça vous fait mal, on vous fera tout faire en anglais», une espèce de délire. En face de lui, les gens courbent l’échine… Est-ce que les gens des usines sont vraiment formés à l’anglais pour aller travailler en Chine?»
On met pourtant beaucoup de moyens à disposition pour la formation continue.
MM: Les moyens sont énormes, mais le gaspillage aussi.
MB: Ce sont souvent des stages pour permettre aux gens de sortir quelques jours de l’entreprise. Les formations continues ne sont pas forcément pensées dans une vision à long terme pour amener des gens de 25 à 67 ans en leur permettant de se former, de s’arrêter, de retravailler, selon la grande idée du parcours de vie en entreprise. La formation continue permet souvent de laisser les gens dans une espèce d’illusion qu’ils se forment. Il faut s’interroger sur l’objectif d’endormissement qui est visé.
Le but est-il bien de donner à chacun la possibilité d’évoluer ou de changer d’emploi en cas de grand changement dans l’entreprise?
MB: Ce devrait être le but. Les pays qui ont la plus grosse croissance et le plus faible taux de chômage ont aussi le plus fort taux de «continuing education» et ils en sont les plus satisfaits.